J’ai rencontré Pierre de Saint-Phalle au consulat général de France lors d’une cérémonie républicaine d’accueil dans la citoyenneté française, célébrant et formalisant l’entrée dans la nationalité française de personnes ayant acquis la nationalité française par mariage, dont son épouse d’origine extra-européenne.
Nous avons poursuivi l’échange avec Pierre, Français aux Pays-Bas.
- Comment êtes-vous arrivé aux Pays-Bas ? et est-ce votre première expatriation ?
Pierre : « Vivre ailleurs, pour le Français que je suis, a toujours été une évidence, je fais mienne cette maxime ‘la vie est un voyage’ et j’aurais l’impression de ne pas pleinement exister si je ne faisais pas l’expérience des autres cultures. Ma famille est très internationale ; un destin familial ? pour ma femme et moi, le choix des Pays-Bas s’est imposé pour de multiples raisons. J’y ai suivi mon épouse qui, en 2020, a obtenu un poste à l’université de Groningue, au Nord des Pays-Bas. Nous avons fait nos études de doctorat en sciences politiques à l’université de Lausanne et y avons soutenu l’un après l’autre notre thèse[1]. Le post-doc se continuant en poste d’enseignement pour mon épouse, nous avons décidé de nous y installer. »
- Votre famille est donc pluriculturelle et plurilingue
Pierre : « Oui, c’est notre quotidien mais c’est aussi mon héritage, tant du côté maternel que du côté paternel. Mon arrière-grand-père de Saint-Phalle a envoyé ses sept fils aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, avec un billet aller-simple ! Certains y sont restés (Niki, ma grand-tante, célèbre artiste est issue de cette branche). D’autres, comme mon grand-père sont rentrés en France, avec ma grand-mère américaine. Du côté maternel, j’ai un héritage culturel russe-ukrainien par mon grand-père, italien et allemand par ma grand-mère. »
- En épousant une étrangère, vous avez donc renoué avec un passé familial.
Pierre : « Oui, je me sens pleinement ‘citoyen du monde’, même si cette expression est aujourd’hui un peu moquée et galvaudée, avec également des séjours et amis en Asie, au Japon et en Mongolie, espaces culturellement plus dépaysants que vivre en Europe et à Groningue en particulier. »
- Venons-en à votre expertise
Vous êtes historien de la pensée politique et étudiez la philosophie économique, donnant cours et conférences, dont plusieurs pour l’Institut Français NL à Groningue. Vous avez mené une recherche sur la dette publique en tant qu’institution sociale et politique dans la France du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire. La dette publique est, pour simplifier, l’ensemble des emprunts contractés par l’État et les administrations publiques pour financer la différence entre les dépenses et les recettes. Cette dette est aussi un produit d’épargne pour les particuliers et un des éléments fondateurs des marchés financiers nationaux et internationaux, et ce dès le XVIIIe siècle. Ce qui vous intrigue particulièrement est le lien historique, principiel et politique entre système représentatif et dettes publiques.
Or, depuis une année et demie, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, au soir des élections européennes, le 9 juin 2024, le sujet de la dette publique en France est au cœur de la vie politique, de la formation des gouvernements qui se succèdent et des propositions de budget. Que peut apporter votre expertise d’historien dans le débat actuel ?
Pierre : « Je peux modestement donner quelques perspectives. La dette publique est un sujet qui revient régulièrement ‘hanter’ le débat public, à chaque échéance électorale ou modification de la ‘note’ de la France.
Je me suis lancé dans son étude en tant qu’objet de débat public car je voulais comprendre la crise de 2010 et le sort réservé au peuple Grec. J’avais trouvé très choquant que la Troïka (Fonds Monétaire International, Banque Centrale Européenne et Commission Européenne) refuse de considérer le referendum grec de refus de leur plan financier. J’ai voulu comprendre ce qui poussait des institutions publiques pourtant très attentives à la démocratie et à la souveraineté, à nier l’expression souveraine et démocratique des Grecs. J’ai voulu faire une généalogie historique de la dette publique, en tant qu’objet financier et politique.
Dans cette optique, la Révolution française, en partie causée par une crise de la dette publique, s’est avérée une porte d’entrée complexe mais fascinante. Pour rembourser la dette contractée pour aider les Américains contre les Anglais [pour des raisons diplomatiques et commerciales, la France soutient militairement et financièrement les treize états unis d’Amérique déclarés indépendants en 1776, dès 1776 en secret, leur procurant matériel, armes et munitions et officiellement en 1778 ; elle s’endette fortement pour financer la guerre et directement les troupes américaines – en mai 1781, 6 millions de livres – (L. Veyssière, BnF.fr)], Louis XVI a besoin de nouvelles ressources fiscales. Or, sous l’Ancien Régime, les plus fortunés sont les aristocrates, grands propriétaires terriens qui ne paient pas d’impôt [sinon la Capitation, instaurée par Louis XIV en 1695). La réforme fiscale nécessaire est le point de départ de la crise de régime qui aboutit à la convocation des États Généraux. Les bourgeois parisiens, petits et grands, détiennent alors massivement la dette française et demandent à être représentés dans le système politique. Le Roi est entre deux feux, les Révolutionnaires veulent protéger la dette qui est leur épargne, les Monarchistes les plus conservateurs veulent l’annuler pour ne pas avoir à céder quoi que ce soit au Tiers État. Pour l’Abbé Sieyès, [célèbre pour son pamphlet sur « Qu’est-ce-que le Tiers-État ? » (1789),] et d’autres, la dette publique est dite « sacrée » et les droits politiques que revendiquent les Bourgeois, doivent être liés à leur pouvoir économique[2].
La dette d’État est un instrument de pouvoir, de puissance, qui peut sauver des États en guerre (le Royaume-Uni au XVIIIe siècle) comme provoquer des troubles intérieurs et mettre à genoux un régime (la monarchie absolue en 1789). C’est un objet difficile à manipuler pour les gouvernants.
En cas de crise, si on annule cette dette souveraine, on ruine les épargnants, membres souvent influents du corps social et politique. Déjà, Montesquieu conseillait aux souverains de paraitre protéger les contribuables, mais de toujours en réalité protéger les créanciers. Car voilà l’équation politique difficile : les créanciers nationaux de l’État sont à la fois contribuables et créanciers. Toute décision vis-à-vis de la dette sert les intérêts des uns et dessert les intérêts des autres. Le pouvoir politique est face à un nœud gordien d’intérêts contraires qu’il ne veut surtout pas être forcé de trancher.
La dette est un flux financier qui sert souvent l’intérêt des plus fortunés et la promesse de l’État est de toujours rembourser afin de pouvoir se réendetter ensuite si nécessaire. Mais jusqu’où faut-il aller pour rembourser la dette ?
Les Révolutionnaires de 1789 décidèrent de tout faire pour rembourser, s’en servant comme d’un levier politique, moyen de transformer la société (impôts progressifs pour tous, démantèlement de l’Église comme acteur économique, vente des biens nationaux, assignats etc…).
Aujourd’hui, certains débats tournent justement autour de l’annulation des dettes pour des besoins écologiques[3]. Ce qui me fascine est la plasticité de ces débats, leur fureur et la permanence de certains tropes ou lieux communs à travers les siècles.
De 1789 à 2025, la dette a changé, les États ont changé et pourtant, aux mots près, on retrouve les mêmes discours, les mêmes caricatures et angoisses.
Le système représentatif va de pair avec un système de dette publique qui fonctionne, depuis la République des Provinces-Unies (1579) et la monarchie anglaise (née de la ‘Glorieuse révolution’ de 1688) jusqu’à nos régimes contemporains,
Si l’histoire ne se répète pas, on peut retrouver des formes analogues avec toutefois des réalités différentes et on peut réfléchir à propos de configurations qui se présentent à différents moments de l’histoire.
Certains discours mettent aujourd’hui en avant l’idée selon laquelle nous léguons la dette publique aux générations futures, tel ‘un fardeau’. J’ai trouvé la première trace de cette métaphore chez Hume [1711-1776]. En réalité, la dette publique est constamment en roulement, elle organise non pas un transfert entre générations mais un transfert financier au temps présent entre ceux qui détiennent la dette et en tirent intérêt et ceux qui paient les impôts. Lorsqu’un arbitrage budgétaire sacrifie un service public pour payer la dette, ce sont les populations qui bénéficient de ce service public qui sont sacrifiés pour protéger ‘la signature de la France’, la valeur de sa dette ou son ‘crédit public’.
Politiquement, nous sommes aujourd’hui dans une situation inverse par rapport à celle de 1789. Les forces de gauche sont en effet le plus souvent critiques du système de la dette publique, promptes à vouloir le réformer ou l’abattre, alors que les forces du centre et de la droite considèrent cette dette comme ‘sacrée’ car le crédit de la France sur les marchés financiers serait en jeu et une catastrophe attendrait toujours les États banqueroutiers.
La dette est un ‘Janus clivant’, mais une fenêtre pour analyser les positions éthiques et politiques des acteurs vis-à-vis de la souveraineté financière et monétaire des États. »
- Comment voyez-vous votre avenir ?
Pierre : « Nous sommes tombés amoureux de Groningue, ayant la chance de vivre en centre-ville. Avec ses très beaux bâtiments de l’époque moderne (XVIIe et XVIIIe siècles) ses jardins et ses canaux, c’est une ville universitaire humainement riche qui a su garder une identité propre. Sa taille réduite permet d’y vivre simplement, avec tout à proximité.
Nous apprécions beaucoup le côté espiègle et direct des Néerlandais du Nord, la richesse culturelle et historique de cette capitale septentrionale et son côté international [c’est l’université de Groningue qui a accueilli les premières chaires universitaires de langues modernes – pour l’allemand en 1881, le français en 1884 et l’anglais en 1886) aux Pays-Bas].
Nous souhaitons rester à Groningue, y ayant développé des relations sociales et d’amitié avec Néerlandais et internationaux, que ce soit avec des collègues de ma femme, des voisins ou des rencontres fortuites du quotidien.
Maintenant que mon épouse est Française, notre avenir est plus serein et notre insertion dans la communauté française des Pays-Bas pourrait prendre la forme d’un engagement au service de nos compatriotes avec qui nous aimons échanger. »
Merci Pierre pour cet échange passionnant, personnel et inspirant, donnant des clés de lecture et de réflexion pour nous, Français aux Pays-Bas.
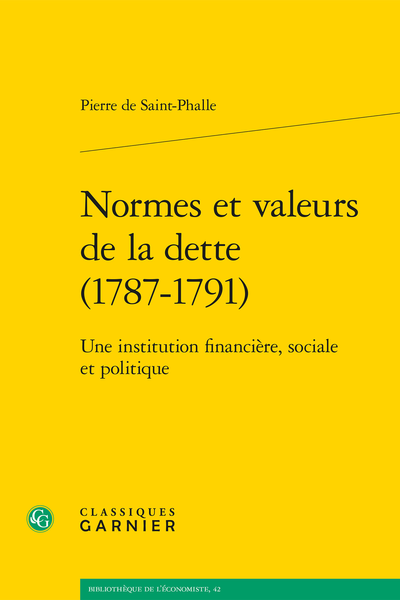
[1] Pierre de Saint-Phalle, Normes et valeurs de la dette (1787-1791). Une institution financière, sociale et politique. Classiques Garnier, 2022.
[2] Sur ce sujet, Pierre de Saint-Phalle (2019). La dette publique : une histoire longue. « L’Avocat, le Banquier et la Banqueroute : la dette publique en débat en France entre 1787 et 1789 ». Oeconomia 9-4. : 727-761. (Lire En ligne) .
[3] « Annuler la dette publique. Contexte et mise en perspective d’un débat ». Dossier critique coordonné par Pierre de Saint-Phalle. Revue européenne des sciences sociales 60-1. 2022. (Lire En ligne).
